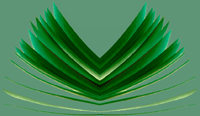Première partie
« On efface le passé pour
mieux détruire l'avenir »
Alice Parizeau
Un peu d’histoire :
un régime issu d’un contrat social?
Avant le 20e siècle, les victimes du travail n’avaient aucun recours spécifique contre leur employeur et devaient invoquer la responsabilité civile afin d’être indemnisées. Cette situation les forçait à s’adresser aux tribunaux civils. Les victimes devaient alors prouver la faute de leur employeur, les dommages subis ainsi que le lien entre la faute et les dommages, ce qui s’avérait souvent impossible compte tenu de la disparité de moyens entre les deux parties. Si elles obtenaient gain de cause, elles se voyaient reconnaître un droit à des dommages et intérêts selon les principes d’indemnisation de la responsabilité civile, notamment la réparation intégrale du dommage subi.
Ce régime entraînait pour une grande partie des victimes des injustices criantes. Tout d’abord, la responsabilité civile, appliquée aux accidents du travail, ignorait le fait que le développement de l’industrialisation dans un contexte de production capitaliste créait une situation dans laquelle les risques que les travailleurs et travailleuses soient victimes d’un accident du travail étaient multipliés de manière exponentielle par les impératifs de la production.
De plus, les coûts qu’entraînait une poursuite devant les tribunaux étaient plus souvent qu’autrement hors de portée pour les travailleuses et travailleurs. Aussi, les employeurs n’étant aucunement contraints de s’assurer, les victimes ayant obtenu gain de cause n’avaient aucune garantie quant à la solvabilité de leur employeur. Il n’était pas rare, lorsqu’il était condamné au paiement de dommages et intérêts, de voir un employeur déclarer faillite et se soustraire ainsi à son obligation en laissant sa victime sans ressource. Enfin, les délais que supposaient de tels recours équivalaient bien souvent à un déni de justice.
Face à la situation des accidents du travail, aux injustices vécues par les victimes et confronté aux pressions du monde ouvrier, Québec institue, en 1907, la Commission d’enquête sur les accidents du travail. Les travaux de cette commission mènent à l’adoption, en 1909, de la Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en résultent. Cette première loi sur les accidents du travail au Québec (et également la première au Canada) établit le principe de la responsabilité individuelle de l’employeur, sans égard à la faute, et l’obligation pour le patron d’indemniser la victime. L’indemnisation de base est alors fixée à 50% du revenu brut mais peut être portée à 100% en cas de faute inexcusable du patron. Toutefois, les victimes doivent encore s'adresser aux tribunaux civils et les employeurs ne sont toujours pas tenus de s’assurer. Les victimes étaient donc encore confrontées à l’insolvabilité de leur employeur et aux coûts exorbitants des poursuites devant les tribunaux.
Malgré le « contrat social » intervenu en 1909, le gouvernement doit mettre sur pied, en 1923, la Commission d’étude sur la réparation des accidents du travail en raison de l’insatisfaction ouvrière et des difficultés d’application de la loi de 1909. La démarche de cette commission conduit à l'adoption, en 1928, de la Loi relative aux accidents du travail qui maintient les principes de la loi de 1909 tout en forçant les employeurs à s’assurer individuellement. Plutôt que d’apaiser le monde ouvrier, la nouvelle loi jette de l’huile sur le feu.
En réponse au mouvement de protestation qui ne cesse de s’intensifier depuis 1928, le gouvernement québécois doit adopter seulement trois ans plus tard, soit en 1931, la Loi sur les accidents du travail qui marque la naissance d’un nouveau régime d’indemnisation et la fin des poursuites devant les tribunaux civils. Les employeurs se voient alors contraints de financer entièrement un régime d’indemnisation des victimes du travail tout en bénéficiant en retour d’un régime collectif d’assurance-responsabilité.
Bien que cette loi ait survécu jusqu’en 1985, elle a été modifiée au cours des ans à des dizaines de reprises pour répondre aux nombreuses insatisfactions ouvrières, notamment pour y faire inclure plusieurs maladies professionnelles, pour indexer les rentes, pour augmenter le niveau d’indemnisation qui passera de 66,6% du revenu brut à 70%, puis à 75% du revenu brut et enfin à 90% du revenu net, etc.
À la fin des années 1970, un scandale allait pousser l’État québécois à réformer la loi de 1931. On apprend alors, par le biais d’une cause qui s’est rendue jusqu'en Cour suprême du Canada (l’affaire Valade), que la CSST a fraudé depuis 50 ans des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs. La loi prévoyait qu’ils soient indemnisés pour la diminution de leur capacité de travail lorsqu’il subsiste une atteinte permanente à leur intégrité physique, ce que la CSST a choisi de ne pas faire. Pour se sortir de ce bourbier, qui risquait de lui coûter des milliards de dollars, la CSST se met frénétiquement à la rédaction d’avant-projets de loi (il y en a eu huit). Le principal objectif visé est de remplacer la notion de l’indemnisation de l’incapacité de travail par la notion du remplacement du revenu, ceci devant bien sûr lui permettre de mettre fin aux rentes à vie et à l’évaluation de la diminution de capacité de travail.
C’est ainsi qu’en 1985, l’actuelle Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est adoptée. La réforme modifie certaines modalités quant à l’indemnisation, notamment sur la réparation de l’atteinte permanente et les rentes à vie, et elle crée des droits nouveaux, tels le droit à la réadaptation et le droit de retour au travail. C’est cette loi qui est visée par l’actuelle démarche de « modernisation » entreprise depuis 2009.
On laisse souvent entendre que notre régime de réparation des accidents et maladies du travail serait issu d’un grand contrat social, intervenu d’abord en 1909 et consolidé par la suite en 1931, entre le monde ouvrier, le patronat et l’État. Par ce « contrat », les travailleuses et les travailleurs auraient renoncé à leur droit à une pleine réparation des lésions professionnelles en échange d’un régime d'assurance-responsabilité sans égard à la faute entièrement financé par les employeurs. Ce discours, fondé sur un mythe, vise avant tout à nous faire croire que nous avons collectivement consenti à la sous-indemnisation et à nous faire accepter cet état de fait.
En effet, qui a pu, en notre nom, donner le « consentement éclairé » nécessaire à la conclusion de ce « contrat »? Ce n’est certainement pas le mouvement syndical, qui ne représentait en 1909 que 5% des travailleuses et travailleurs au Québec et à peine 9% en 1931. Et ce ne sont certainement pas les travailleuses et travailleurs non-syndiqués qui n’ont jamais pu se prononcer sur ces réformes par voie référendaire ou autrement.
L’histoire nous enseigne bien au contraire que les différentes réformes touchant la réparation des accidents et maladies du travail ont plutôt tenté de répondre à des luttes ouvrières qui dénonçaient une législation injuste. Ces luttes sont des indices probants qui démontrent que ce fameux « contrat social » n’est qu’une fumisterie.
En fait, l’histoire nous démontre que les travailleuses et les travailleurs n’ont jamais renoncé à la réparation intégrale des accidents et maladies du travail; leurs luttes ont toujours été menées afin de cheminer vers cet objectif.